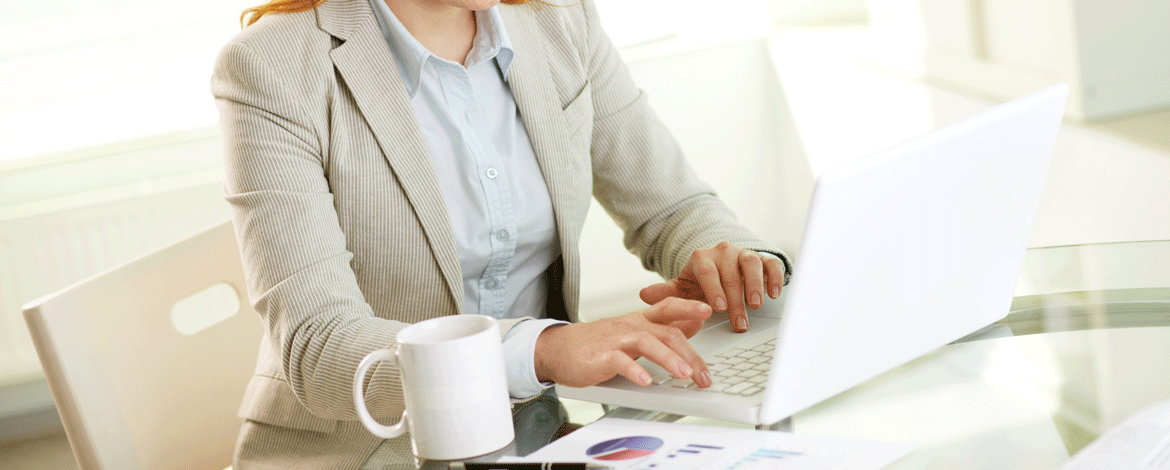Veille juridique
La veille juridique est une veille spécialisée dans le domaine du droit. Elle permet, en fonction de l’actualité, de faire émerger les points importants de l’évolution du droit. En effet, elle prend naturellement en compte les évolutions législatives et règlementaires mais aussi les évolutions jurisprudentielles qui interviennent en les analysant, en faisant apparaître leurs apports et leur intérêt pour le droit.
Identifier les nouveautés importantes pour le droit
La veille juridique va avoir pour mission d’identifier les nouveautés importantes pour le droit, de les traiter, pour en faire ressortir leur impact sur les normes en vigueur et de les diffuser, pour les porter à la connaissance des justiciables.
En effet, elle permet d’anticiper les changements liés à l’adoption de nouveaux textes de loi mais aussi d’anticiper éventuellement l’impact de l’application des normes européennes (directive, règlement et recommandations) et internationales, qui sont parfois invocables directement devant les juridictions nationales.
Se tenir au courant de l’évolution des normes juridiques
En somme, elle permet aux entreprises et aux salariés de se tenir au courant de l’évolution des normes juridiques afin d’identifier les bonnes sources d’informations et de savoir ce qui est permis ou non par le droit en vigueur car selon un célèbre adage : « nul n’est censé ignoré la loi ».
Vous trouverez donc ici, des veilles analysant l’actualité juridique, retraçant les nouveautés importantes sous forme d’une étude ayant pour vocation d’éclairer les justiciables.