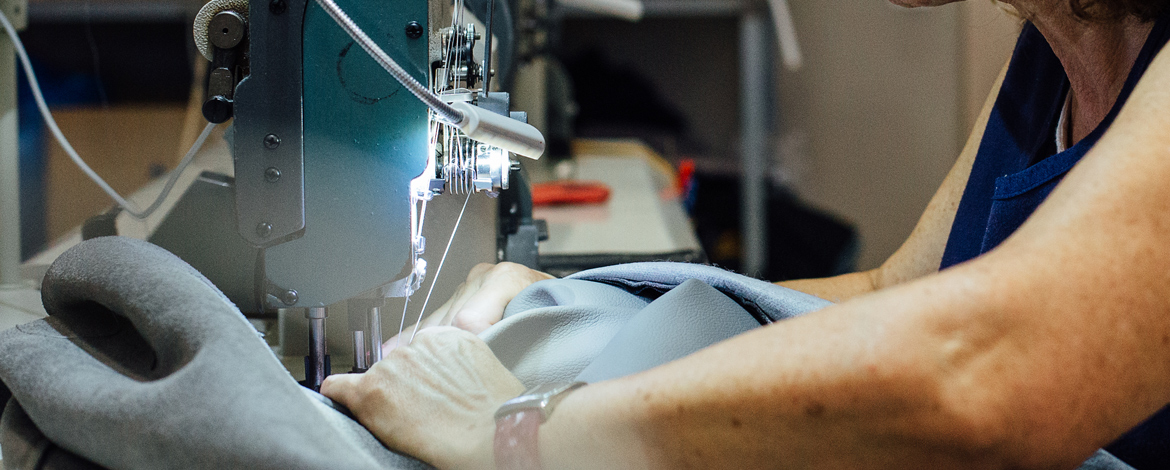Justice du Travail
En France, la justice du travail est traditionnellement assurée par le Conseil de prud’hommes qui absorbe la grande majorité des litiges entre employeurs et salariés. Cependant, lors de litiges spécifiques d’autres juridictions peuvent intervenir.
Quel tribunal compétent en Justice du Travail ?
Ce sera parfois le cas avec le Tribunal administratif qui sera compétent lors d’un litige avec un salarié protégé ou avec le Tribunal de grande instance qui sera compétent lors d’un contentieux sur un accord collectif ou encore avec le Tribunal d’instance qui lui sera spécifiquement compétent lors d’un contentieux autour des élections professionnelles ou lors d’un contentieux faisant intervenir certaines catégories de salariés (marins). Enfin, lorsqu’un litige porte sur le droit pénal du travail, c’est le Tribunal correctionnel qui sera saisi.
Ainsi, lorsqu’un litige est né à l’occasion d’un contrat de travail, il est possible de saisir le Conseil de prud’hommes. Mais, il est important de souligner que la justice du travail a toujours eu pour ambition le règlement amiable des conflits entre employeur et salarié. En effet, avant d’être portée devant le bureau de jugement, chaque conflit doit faire obligatoirement l’objet d’une tentative de conciliation. Ici, les parties tentent de trouver un accord pour éviter la procédure contentieuse. Ce n’est qu’en cas d’échec de cette conciliation que les parties sont renvoyées devant le bureau de jugement.
Par ailleurs, chaque partie à la possibilité de se faire assister ou représenter par un collègue de la même branche ou par son conjoint mais aussi par un avocat. Il est à noter que cette possibilité a été renforcé par la loi Macron puisque dorénavant cette faculté est offerte dans tous les cas. En effet, même si l’assistance par un avocat devant le Conseil de prud’hommes n’est pas obligatoire, elle est très fortement conseillée.
Il est à noter que depuis le décret du 20 mai 2016, les parties ont également la possibilité de se faire assister par le défenseur syndical.
En outre, une procédure de référé est possible. Elle permettra, dans les cas d’urgence, d’obtenir très rapidement une décision de justice (contestation sérieuse, prévention d’un dommage imminent, trouble manifestement illicite). Dans cette procédure, il n’y a pas de conciliation préalable et ainsi le litige trouvera une réponse dans un délai de 2 à 6 mois.
Enfin, l’appel sera principalement interjeté devant la Cour d’appel et exceptionnellement devant la Cour d’appel administrative. En définitive, il faut savoir qu’un dernier recours est possible devant la Cour de cassation (chambre sociale ou criminelle) ou exceptionnellement devant le Conseil d’état.